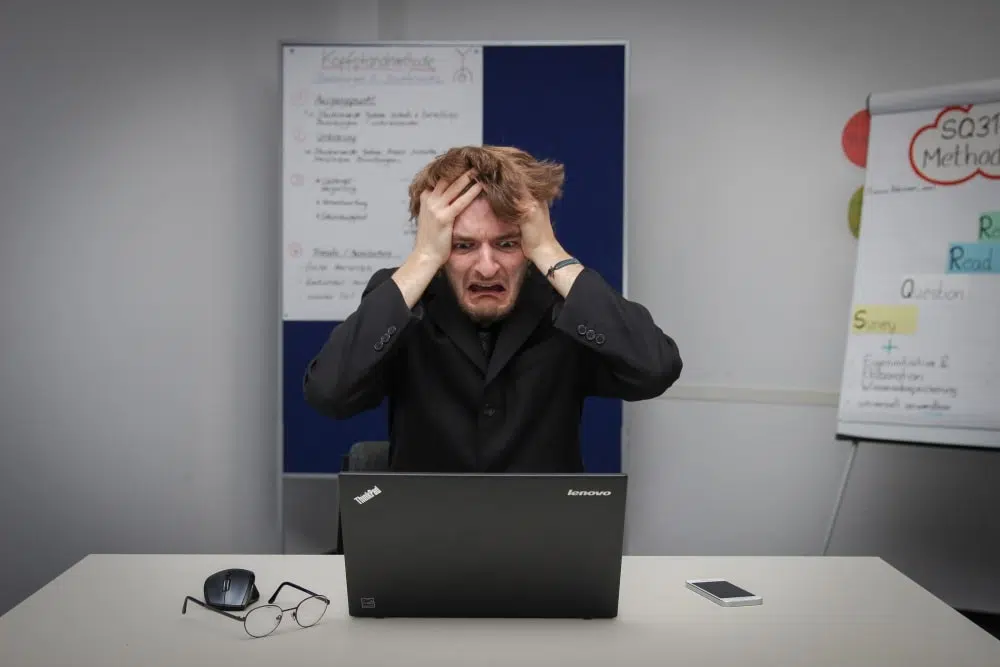
Faites ou faîtes ? Dites ou dîtes ? Ne faites plus la faute !
Vous hésitez toujours entre faites et faîtes ? Dites et dîtes ? Ne faites plus la faute dans vos comptes rendus ou mails pro. Nous vous expliquons tout.
Lire la suite
Déplacer facilement un point sur Word
Gagnez du temps dans la rédaction de vos rapports, PV ou comptes rendus. Découvrez comment déplacer en 2 clics l’intégralité d’un point de votre document.
Lire la suite
Comment utiliser une feuille de style Word ?
Simplifiez-vous la vie avec vos rapports ou comptes rendus professionnels. Apprenez à utiliser une feuille de style Word.
Lire la suite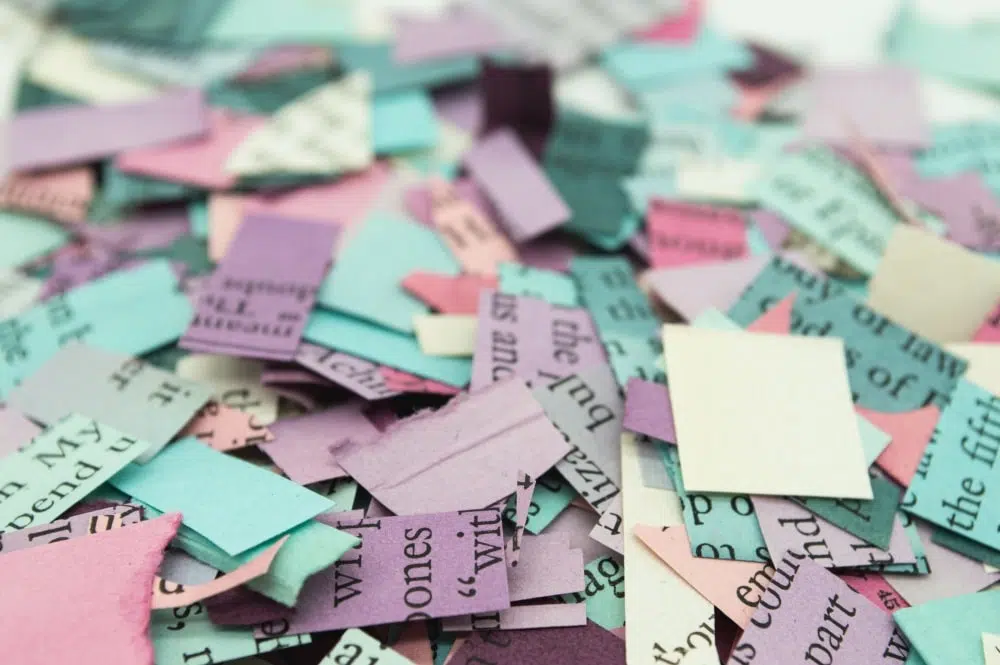
3 astuces pour coller votre texte sans mise en forme dans Word
Pour gagner du temps et ne pas recopier manuellement les éléments d’un […]
Lire la suite
Créez un raccourci automatique sur Word en 2 minutes
Comme beaucoup, vous avez une utilisation professionnelle de Word, pour écrire vos […]
Lire la suite
Word : comment numéroter les pages ?
Lorsqu’un document fait plusieurs pages, il est indispensable de les numéroter. Découvrez la méthode pour gérer la numérotation des pages sur Word.
Lire la suite
Quels logiciels utiliser pour une prise de notes efficace ?
Vous êtes secrétaire de CE, CHSCT ou CSE. Vous devez faire le PV de vos réunions mensuelles. La rédaction de comptes rendus n’est pas votre métier et vous souhaitez avoir quelques astuces pour prendre des notes efficaces qui vous permettront d’être plus à l’écoute en séance et de gagner du temps à la rédaction ? Voici un diaporama des technologies et logiciels disponibles pour une prise de notes efficace.
Lire la suite
Prise de notes : les abréviations essentielles
Parce que vous êtes en charge d’écrire le compte rendu de votre prochaine réunion, c’est à vous que revient le plaisir de la prise de notes. Pas de panique ! nous avons quelques trucs et astuces pour vous simplifier le travail. Voici une liste (non exhaustive) des abréviations que vous pouvez utiliser et qui devraient vous faire gagner un temps précieux !
Lire la suite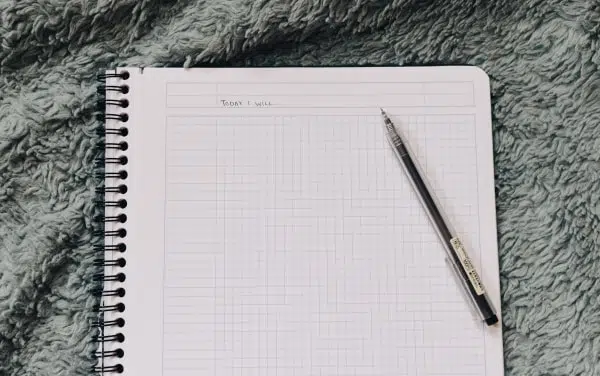
Rédacteur de comptes rendus : un métier à part entière
Vous êtes secrétaire d’un CE ou d’un CHSCT et devez donc régulièrement assurer la rédaction du compte rendu des séances… une tâche qui vous prend du temps et qui finalement, ne s’avère pas si facile qu’elle vous le semblait. Après tout, qu’y a-t-il de si compliqué à prendre des notes et à rédiger un compte rendu ? Rien en effet… quand c’est son métier ! Mais voilà, mis à l’épreuve devant votre écran, vous êtes confronté aux difficultés de l’exercice…
Lire la suite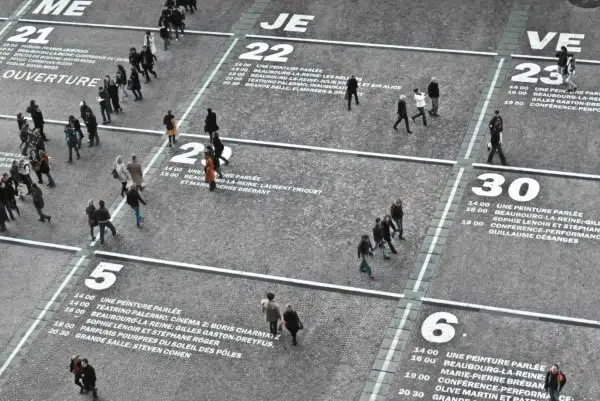
Fusion des instances : faut-il s’attendre à une réduction du nombre de réunions ?
La fusion des instances est une source d’interrogation pour le secteur de la rédaction de comptes rendus. Avec des instances réunies, certains rédacteurs craignent que le nombre de réunions à couvrir diminue, ou que les règles soient modifiées. Sans prétendre voir l’avenir, nous faisons le point sur les conséquences à anticiper au vu de la réglementation adoptée récemment.
Lire la suite
Tapez plus vite sur Word et Outlook grâce à l’insertion automatique
Vous écrivez plusieurs fois par jour les mêmes phrases, expressions ou noms : intervenants dans un compte rendu, adresse de facturation, numéro SIRET… Et si en deux touches, vous insériez automatiquement le nom de l’intervenant et sa fonction en gras, souligné ? Cette fonction existe nativement sur Word : l’insertion automatique. Je vous explique tout.
Lire la suite
Corrigez automatiquement vos fautes les plus courantes sur Word
Plus vous rédigez, plus vous écrivez vite. Et plus vous écrivez vite, plus vous êtes susceptible de commettre régulièrement les mêmes fautes de frappe. Pour ne plus perdre de temps à corriger vos fautes, optez donc pour la correction automatique de Word – qui fonctionne sur tous les logiciels de la suite Microsoft Office.
Lire la suite
Comment faire une bonne prise de notes pour un rédacteur absent en réunion ?
Vous devez enregistrer et prendre en notes une réunion pour un rédacteur qui n’y assiste pas. Vous avez peur de ne pas lui apporter les éléments nécessaires. Découvrez les 9 points simples à respecter qui vous garantiront de faire une prise de notes qui résiste à toute épreuve.
Lire la suite
J’ai enfin appris à frapper à 10 doigts !
J’ai enfin appris à frapper à 10 doigts ! Voici comment j’ai fait : des outils en ligne pour y arriver et quelques conseils pour apprendre avec efficacité.
Lire la suite
4 logiciels indispensables à tout rédacteur de comptes rendus
Vous êtes rédacteur indépendant ou rédigez régulièrement des comptes rendus. Vous souhaitez aller plus vite ou améliorer votre confort. Découvrez les 4 outils informatiques dont vous ne pouvez pas faire l’économie.
Lire la suite
Perles de comité d’entreprise
Les rédacteurs passent beaucoup de temps en réunion, où ils peuvent y entendre parfois des répliques assez… décalées. Que vous soyez rédacteur ou partie prenante d’une IRP, voici quelques tirades récentes entendues en réunion, pour se détendre un peu.
Lire la suite
Comment prendre des notes en réunion ?
Vous êtes chargé pour la première fois de rédiger le compte rendu de votre prochaine réunion (CE, CHSCT, CA…). L’exercice fait a priori peur, mais ne vous inquiétez pas : ces quelques conseils vous permettront non seulement de disposer d’une bonne prise de notes, mais surtout de rédiger un excellent compte rendu par la suite.
Lire la suite
Créer et actualiser une table des matières automatique sur Word
Vous souhaitez gagner du temps dans la rédaction de votre compte rendu et disposer d’un sommaire automatique qui, en quelques clics seulement, reprendra les titres de vos documents et le numéro de la page y afférant, mais vous ne savez pas comment faire ? Nous vous disons tout.
Lire la suite
Rédacteur, comment faire face à une catastrophe ?
La rédaction, c’est comme la vie : on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe. Alors pour éviter toute solution précipitée, source de plus de dégâts que de réparations, voici une petite liste de désastres auxquels vous pouvez être confronté(e) – et les solutions que nous vous suggérons.
Lire la suite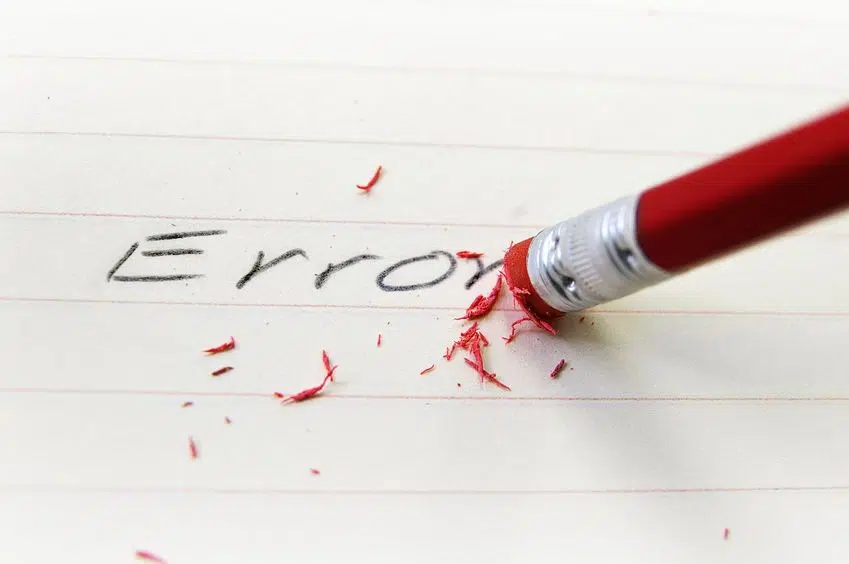
Antidote 9 : des améliorations utiles, mais non vitales
Faut-il passer à la version 9 d’Antidote ? Voilà la question que je me suis posée lorsque la mise à jour est sortie. Au quotidien, le correcteur à la fiole est pour moi un élément aussi capital que Word et Express Scribe. Néanmoins, les nouveautés mises en avant par Druide valent-elles vraiment un nouvel investissement ?
À tous ceux qui hésitent encore, voici un article qui répondra à toutes vos questions.
