DÉLÉGUEZ LE COMPTE RENDU
à un rédacteur professionnel
Concentrez-vous sur les débats
En tant que secrétaire ou secrétaire adjoint d’une Instance Représentative du Personnel (IRP), vous savez que bien communiquer est la clé de votre mandat. Encore faut-il trouver le temps de tout faire.
Profitez de l’expertise de votre rédacteur.

COMPTES RENDUS DE CSE, CSSCT et CSEC
quelles sont les obligations légales ?
La loi prévoit que le secrétaire du CSE est responsable de la rédaction du procès-verbal de CSE.
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 – Article R2315-25 – “A défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L.2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.”
S’agissant de la CSSCT et du CSEC, les PV sont essentiels car ils servent de référence en cas de litige et de base de travail aux élus du CSE dans leurs discussions avec l’employeur.
Externaliser la prestation de rédaction du compte rendu (PV de CSE, PV de CSSCT ou PV de CSEC) à un rédacteur professionnel est une solution efficace, simple à mettre en place et souple, qui vous permet de travailler à la gestion de l’instance de manière sereine.
S'agissant du CSE et de la CSSCT, le budget de fonctionnement du CSE peut servir à payer cette prestation. Vous pouvez également négocier avec la Direction pour qu’elle prenne en charge une partie du coût de la prestation. Le financement de la rédaction des comptes rendus de CSEC est quant à lui généralement assuré par les différents CSE d'établissement.
LA RÉDACTION DU PV DE CSE, CSSCT et CSEC
une tâche chronophage et parfois complexe


QUELLES SONT VOS OPTIONS
pour la rédaction du PV de CSE, CSSCT ou CSEC ?
Non, la Direction n’est pas autorisée à rédiger le procès-verbal de l’instance représentative du personnel, CSE ou CSSCT. La Direction ne peut pas non plus déléguer la rédaction du compte rendu à un membre des services de direction, comme une secrétaire de direction par exemple.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-96.612 : « Si la rédaction matérielle du procès-verbal des délibérations du comité d’entreprise peut être confiée à une personne étrangère au comité d’entreprise, l’établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité (…) ».
Les membres du CSE peuvent par exemple rédiger chacun leur tour le compte rendu de réunion, pour que cette charge soit répartie équitablement entre tous les membres de l’instance.
Concrètement, cette manière de procéder est rare, car c’est le secrétaire de l’instance qui dispose d’heures de délégation pour réaliser cette tâche. Sauf à disposer eux aussi d’heures de délégation, les autres membres de l’instance ne sont généralement pas enclins à y consacrer du temps.
La loi prévoit que la rédaction du PV de CSE peut être confiée à un prestataire externe.
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 – Article D. 2315-27 – « L’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34. Lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles. Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique. »
La rédaction des comptes rendus de CSSCT et CSEC peut, au même titre, être déléguée à un prestataire externe.
TRAVAILLER AVEC CODEXA
ce que ça veut dire pour vous
80% d’IRP (CSE, CSSCT, CSEC…) en portefeuille clients
Santé, industrie, culture, agroalimentaire, services, commerce, transport. Des rédacteurs spécialisés dans votre secteur d’activité.
Aucun engagement de volume ou de temps
Nos clients restent parce qu’ils sont satisfaits.
Confidentialité et sécurité
Un espace client sécurisé et intuitif pour faciliter la transmission des informations. Tout est au même endroit.
ILS NOUS FONT CONFIANCE
et nous en sommes fiers !


QUE VOUS APPORTE
le rédacteur de compte rendu ?
Neutralité
Rapidité
Tranquillité d’esprit
Simplicité
Efficacité
Partage d’information
CE QU’EN PENSENT
nos clients
UN DEVIS,
UNE QUESTION
Contactez-nous
PME ou grands groupes, nous
avons le rédacteur qu’il vous faut.
CAS CLIENTS
quelques partages d’expériences

Une exigence de qualité rédactionnelle satisfaite
La flexibilité et la réactivité des équipes de Codexa est dédiée au service du CSE.
Lire le cas client
Un compte-rendu sur mesure
Codexa s’adapte aux demandes particulières de ses clients en matière rédactionnelle.
Lire le cas client
Se concentrer sur le cœur de notre mission
L’externalisation de la rédaction du PV de CSE permet de nous concentrer sur les débats.
Lire le cas client
Des procès-verbaux irréprochables
En présentiel comme à distance, les comptes rendus conservent une haute qualité rédactionnelle.
Lire le cas clientRédiger le procès-verbal de CSE sans enregistrement
Les rédacteurs de Codexa peuvent fournir une synthèse en se basant uniquement sur leur prise de notes
Lire le cas clientUn processus d’approbation des PV fluide grâce à l’externalisation
Grâce au compte rendu exhaustif, les intervenants ne contestent plus ce qui a été dit en séance.
Lire le cas client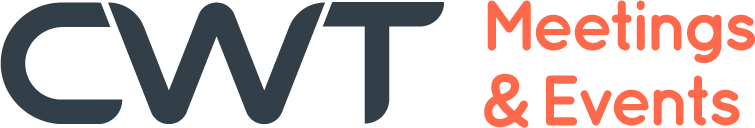
La rédaction de vos comptes rendus à partir de votre enregistrement
Fournir son enregistrement pour la rédaction du PV : la solution la plus économique pour gagner du temps.
Lire le cas clientUn galop d’essai concluant
Codexa propose une mission test pour vous donner le temps de vous engager et bien choisir votre prestataire.
Lire le cas clientRédiger, ce n’est pas notre travail
Le budget de fonctionnement du CSE est fait pour ça : autant profiter de l’expertise d’un rédacteur professionnel.
Lire le cas client
La neutralité avant tout
Rédiger sans parti pris n’est pas évident quand ce n’est pas son métier. La neutralité, c’est le plus important.
Lire le cas clientLa présence d’un rédacteur est un gage de neutralité
Par la fidélité de ses comptes rendus, Codexa permet de se concentrer sur l’essentiel : la défense des salariés.
Lire le cas clientmodèles, règles & astuces

PV de CSSCT
Tout ce que vous devez savoir sur le PV de CSSCT : ce que dit le code du travail, modèle de PV de CSSCT, ce qu'il faut faire en cas...Lire la suite

À qui déléguer la retranscription de votre PV de CSE, CSSCT ou CSEC ?
Trouver une solution en interne ou prendre un prestataire externe ? Qu'avez-vous le droit de faire pour la retranscription de votre PV de CSE, CSSCT ou CSEC ?Lire la suite

Diffusion du PV de CSE : Code du travail, bonnes pratiques
Quand et comment diffuser le PV de CSE ? Qui affiche le PV du CSE ? Comment faire du compte rendu de CSE un véritable outil de communication auprès des...Lire la suite

Qu’est-ce que l’IC-CHSCT ?
L’IC-CHSCT est une sorte de supra CHSCT, qui regroupe des représentants de différents CHSCT dont les périmètres sont impliqués par un même projet. On vous explique tout.Lire la suite

CSE de moins de 50 salariés : bonnes pratiques et résolution de conflits
Tout ce qu'il faut savoir pour que les réunions de CSE se passent au mieux dans les entreprises de moins de 50 salariés : ordre du jour, convocation, information des...Lire la suite

Modèle de compte rendu de CSE, CSSCT, CSEC
Téléchargez un exemple de compte rendu de CSE et découvrez nos astuces métier pour rédiger un bon PV de CSE. On vous explique tout.Lire la suite

PV d’enquête CSSCT
Tout ce que vous devez savoir sur le PV d'enquête CSSCT : comment faire le PV, quel formalisme respecter, modèle gratuit de PV de CSSCT, etc.Lire la suite

Confiez la rédaction de votre PV de CSE à une société extérieure
La rédaction du PV d'une réunion est une tâche fastidieuse. Des rédacteurs professionnels peuvent s'en charger pour vous. Quels sont les critères pour sélectionner votre prestataire ? Quel intérêt pour...Lire la suite

Délai de rédaction PV de CSE : Code du travail, conseils pratiques
Comment respecter le délai de rédaction du PV de CSE, CSSCT ou CSEC alors que le législateur l'a encore raccourci ? Négocier un délai supplémentaire ou externaliser la rédaction du...Lire la suite

Comment faire un compte rendu de CSE ?
Maintenant que vous disposez de notre modèle de PV de CSE, découvrez ce qu'il faut en faire avant, pendant et après la réunion. Gagnez un temps précieux et rédigez un...Lire la suite

Enregistrer une réunion de CSE : quelles sont les règles ?
Quelles sont les règles à connaître pour enregistrer les réunions de CSE ? Comment faire ? On vous explique tout.Lire la suite

PV de CSE : tout ce qu’il faut savoir
PV de CSE : quelles sont les règles pour la rédaction du PV de CSE, son approbation, son affichage ? Téléchargez un modèle de PV de CSE gratuit. Nos réponses...Lire la suite

Délai de rédaction du PV de CSE : Code du travail, conseils pratiques
Comment respecter le délai de rédaction du PV de CSE imposé par le Code du travail ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Suivez nos conseils.Lire la suite

Modèle de compte rendu de délégués du personnel (DP)
Vous êtes chargé de la rédaction du registre spécial DP ou du compte rendu des réunions de DP ? Téléchargez notre modèle de compte rendu gratuit pour gagner du temps.Lire la suite

Désaccord PV de CSE, PV de CSE non approuvé : que faire ?
Que faire en cas de conflit dans l'approbation du PV de CSE ? Désaccord PV de CSE, PV de CSE non approuvé : on vous explique tout.Lire la suite